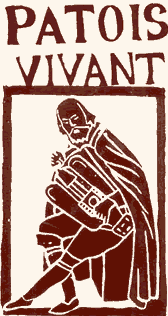|
|
|
|
|
|
|
Poèmes en ligne Lo
Mouma Kan
ouèrïn tcheton Mon
fiolë Mu
éssio Le
bo Le
chavo Bicho Lé
donde Confesso
d'ïn chin borgé Tche
ogné Ino
coyounè Lu
bru L'écoussou Prïntin Moriajou
do porpouyë L'orô Migaudo Le Lignouon Le Loui é lo Mélènie Pô lo rotô
dô Retchôlon Le Boutchïn é
l'étialô Inô chiorô
jouénô Dépotinto, dépotintè Lô chiorô é
le lô Brayi de coucu Pô d'émou Intô lé donc
? Notrô lingö
Voir
aussi
pages spéciales le travail de félibre du Père Jean Chassagneux capitale du patois forézien
|
|

Château
de Chalmazel
Le dernier poète patoisant du Forez
(patois
de Chalmazel)
A la découverte d'un poète, Xavier Marcoux
par Danièle Latta
1 - Un poète patoisant
Des poèmes en patois
Le groupe "Patois vivant" est né en février 1976,
au Centre social de Montbrison. Des Foréziens attachés à
leur "vraie langue" ont l'idée de se réunir une
fois par mois afin de parler, de rire, de chanter, de raconter des histoires
selon la tradition des veillées d'autrefois. Et l'on parle le patois
bien sûr. Grand succès de cette entreprise qui attire et
rassemble des gens très divers.
Moins d'un an après, en janvier 1977, le premier bulletin du groupe
"Patois vivant" voit le jour, réunissant des textes donnés
par les participants ou enregistrés au cours des soirées.
On y trouve un poème de Xavier Marcoux : Les Dondes. Son patois,
c'est celui de Chalmazel, du hameau de Nermond où il est né
le 18 mars 1911. Le supplément au n° 2 du bulletin (septembre
1978) contient exclusivement 26 poèmes de Xavier Marcoux, certains
"chantés", tous datés de 1977 ou 1978. Sur son
exemplaire il a ajouté, en mention manuscrite, la dédicace
suivante : A mes parents Eugène Marcoux,
Marie Viot, qui m'ont appris le patois.
Cet hommage dit déjà l'essentiel mais un passage nous renseigne
sur le déclic qui est à l'origine de l'écriture de
ces poèmes. Il y a quelques années, le Père Gardette
m'écrivait : "ce qui manque le plus à notre dialecte
franco-provençal, c'est de la poésie." Amoureux de
ma langue maternelle, je me suis dit le Père Gardette fait un appel…
Tout le monde est poète, paraît-il, il faut essayer !
Ou é pré l'écoussou è
pïn, pan, pô, sué tôboulô su tô pôyè
et avec les encouragements de mes amis du groupe Patois vivant, voilà
ce qui en est sorti.
Pour ses amis, Xavier Marcoux était bien, parmi eux, le poète.
Aujourd'hui, nous publions dans ce numéro 26 poèmes de 1977
et 1978 et 17 autres écrits entre 1978 et 1984. Xavier Marcoux
les avait copiés dans un grand cahier de comptes à couverture
marron qu'il gardait près de lui dans son magasin de la rue Tupinerie.
Les poèmes sont écrits tantôt en hauteur, tantôt
en largeur, accompagnés souvent de la traduction en français,
à l'encre rouge, pour la distinguer du patois. Quelques notes précisent
le sens d'un mot, donnent une indication supplémentaire sur un
personnage, montrent le soin apporté par l'auteur à la transcription
de ses textes. Avait-il d'autres brouillons ? C'est difficile à
dire. La poésie, cela vient souvent en marchant, cela se modèle
dans l'esprit, cela passe par la voix, jusqu'à la forme juste.
On trouve des corrections inscrites sur de petites gommettes ou sur des
étiquettes collées par-dessus le texte à corriger.
Quelques ratures, des ajouts, quelques textes barrés. Tout ce travail,
patient et appliqué, émouvant à étudier, montre
que Xavier Marcoux envisageait une publication.
Une autre publication des
poèmes
Joseph Barou a eu l'initiative de la présente édition de
ces poèmes. Elle est bilingue cette fois-ci, par souci de permettre
à tous les lecteurs de goûter ces textes. Trop de patoisants
ont disparu emportant avec eux la connaissance de cette langue dont je
ne possède moi-même que quelques rudiments, mais la traduction
me renvoie aux mots du franco-provençal. Ces mots sont mis dans
une certaine cadence, souvent avec des rimes et les images qu'ils créent
me parlent peu à peu, me parlent d'un pays que j'ai appris à
aimer, celui des monts du Soir, celui des hautes chaumes des monts du
Forez.
Tout un univers apparaît avec les villages, les rivières,
les chemins, les arbres, le ciel de l'aube et les constellations de la
nuit. Tout un monde presque disparu resurgit, celui des animaux traditionnels
de la ferme - les vaches dressées, le cheval, les cochons, le bouc
- celui des petits bergers des jasseries qui fabriquent des sifflets et
font claquer leurs sabots sur les chemins. Tout le quotidien des gens
de la montagne nous est restitué avec malice ou émotion
à travers le langage des objets, les odeurs, les bruits. Et ce
n'est pas vain regret d'un passé idyllique, ou sentimentalisme
mièvre, mais authentique mémoire.
Xavier Marcoux, avec passion, avec jubilation, communique les impressions
profondes de son enfance, ce qui l'a fondé, comme l'on dit maintenant,
et il le fait en usant de cette langue, notrô
lingô, ce sont ses mots, E lé
si jintô / Notrô lingô / Oué în trésore.
2 - Une vie
Xavier Marcoux est né le 18 mars 1911 au hameau de Nermond dans
la commune de Chalmazel. Sa maison natale venait des Viot, du côté
de sa mère, et son père, né à Champcolomb,
était "venu gendre" à Nermond. Xavier est le dernier
de sept enfants ; il apprend le français à l'école
car, chez lui, on ne parle que le patois. Tout jeune, il est petit berger
dans les jasseries avec la "Maine".
On le destine à la prêtrise et il fait ses études
d'abord au collège des Salles (comme le Père Canard) ; quatre
années de collège pendant lesquelles il ne revient à
la maison qu'aux vacances. Puis il entre au Petit Séminaire de
Montbrison et fait ensuite une année de Grand Séminaire
à Lyon. Mais il arrête ses études et ne se sent pas
la vocation de la prêtrise.
Il a 20 ans en 1931 et il exerce différents métiers à
Lyon, à Grenoble, à Clermont-Ferrand. Il travaille ensuite
comme comptable chez Berliet à Vénissieux, dans la banlieue
lyonnaise. Il se marie en 1940 avec Marie-Antoinette Boudin, infirmière
- visiteuse, née à Firminy le 10 avril 1914 dans une famille
de commerçants artisans. C'est une amie de sa sœur Angèle
qui a épousé un de ses collègues de travail, Henri
Roux.
Te me fi conutre mô fenô,
Tu me fis connaître ma femme
ô te fiu conutre ton hômou, je te fis connaître
ton mari
La femme de Xavier Marcoux exerce quelque temps son métier puis
tient un magasin de vêtements rue Garibaldi à Lyon. Deux
filles naissent, Maryvonne en 1941 et Marie-Claude en 1942.
Au vu des difficultés de la vie quotidienne, Xavier Marcoux et
sa famille quittent Lyon en 1943 et s'installent à Montbrison où
vivent les parents de Marie-Antoinette. Le jeune couple tient alors deux
commerces de vêtements : "Le Printemps" et "Les deux
Passages" et habite d'abord à l'angle du quai de la Porcherie
et de la rue Notre-Dame, puis rue de la République, à côté
de l'usine à gaz. Une troisième fille, Christiane, naît
en 1946, puis un garçon, Jean-Luc , en 1949. Deux autres filles
viennent ensuite, Marie-Dominique, née en 1952 et Mireille en 1957.
Peu après cette dernière naissance, Xavier Marcoux a la
douleur de perdre sa femme. Il travaille encore longtemps, élevant
ses six enfants et tenant sa boutique à l'angle de la rue Tupinerie
et de la rue Notre-Dame. C'est là que je me rappelle l'avoir vu
dans les années 70. C'était une figure montbrisonnaise.
La famille garde des contacts avec Chalmazel où elle se rend assez
souvent pour des visites à des cousins ou des promenades dans la
montagne. Xavier Marcoux continue ainsi de parler le patois. Il reste
aussi très lié avec sa sœur, Angèle Marcoux
- Roux, qui est veuve et vit seule avec sa fille Geneviève . Il
a le goût de la famille et voit naître avec bonheur ses petits-enfants.
C'est au fil du temps que dans son grand registre de poèmes on
les voit grandir. Il doit d'ailleurs les initier à la poésie.
Tel poème en acrostiche le prouve (poème en français),
sans doute écrit en commun. Il a d'autre part soigneusement gardé
des poèmes de ses petits-enfants.
En 1991, on célèbre ses 80 ans et toute la famille se met
à rimailler :
C'est aujourd'hui l'occasion / De sortir notre érudition./ En dignes
descendants de Xavier / Nous nous sommes mis à rimailler / Pour
souhaiter Bon anniversaire / Au plus gentil des pères et grands-pères.
Il recopie des poèmes, d'une écriture que la maladie rend
un peu tremblante. Mais c'est un exercice qu'il s'impose car le courage
ne lui manque pas. Il peaufine aussi la traduction de ses poèmes
car il sait que la langue de son enfance se perd et que les plus jeunes
de la famille ne la connaîtront pas.
Xavier Marcoux meurt le 22 avril 1992, à 81 ans.
On peut penser que la poésie l'a accompagné tout au long
de sa vie et qu'il a su la faire goûter aux autres. Dans les papiers
qu'il a laissés, au dos d'une carte de visite d'un fournisseur
parisien, on peut lire ce poème de Charles d'Orléans que
tous nous avons appris à l'école :
Le temps a laissé son manteau / De vent
de froidure et de pluie…
Ce rondeau, du début du XVe siècle, garde un charme tout
neuf par la simplicité de ses thèmes et par son rythme léger.
Nul doute qu'il ait plu à notre ami Xavier Marcoux, et, qu'à
la fin de sa vie, il ait eu, un jour, le désir de le recopier,
de mémoire peut-être, sur un petit rectangle de bristol,
montrant par là son appartenance à la grande famille des
poètes.
3 - L'œuvre poétique
Le choix du
patois
Dans un article du Progrès
de novembre 1978, Monique Damon-Bonnefond cite des paroles de Xavier Marcoux
évoquant son enfance :
Jusqu'à l'âge de 6 ans, je n'avais
jamais entendu parler français. Mes parents, agriculteurs, mon
entourage, paysan, ignoraient la langue nationale.[…] Lorsque j'entrais
à l'école, le maître nous apprit, à mes camarades
et à moi-même, à manier la langue française…
[…] Nous continuions à pratiquer le patois en début
de la classe, à la récréation, chez nous. Mais j'ai
su, bien plus tard, que les maîtres préféraient enseigner
de jeunes paysans comme nous qui arrivions incultes, à l'école,
plutôt que ceux d'entre nous qui avaient appris quelques bribes
de français mais de façon gauchie et qui éprouvaient
beaucoup plus de difficultés que nous pour se débarrasser
de mauvaises prononciations.
Le patois est la langue maternelle de Xavier Marcoux, celle de ses premières
découvertes, des émotions qui laissent leur empreinte pour
la vie. Quand il a écrit des poèmes, il l'a fait en patois
parce que toute poésie renvoie à l'enfance. On trouve plusieurs
thèmes et diverses sources d'inspiration et cette présentation
a pour but d'aider chaque lecteur - même non patoisant - à
entrer dans cette pensée du poète, à mieux goûter
ses mots et à apprécier la variété des rythmes
et la richesse de cette langue.
L'enfance
Voici d'abord l'univers de la petite enfance avec la figure de la mère.
Puis les jeux, les malices et les occupations des jeunes enfants.
Lô Mouma (La Maman) fait
le portrait d'une femme toujours levée la première et couchée
la dernière qui " donne, donne " à tout le monde
et avec le sourire :
Ou'ère son plézi / To son plézi. C'était son
plaisir / Tout son plaisir.
C'est aussi l'évocation des occupations de l'enfant dans le poème
intitulé Kan ou érïn tcheton,
qui commence justement par cette phrase du vieux folklore français
: Quand j'étais petit, je n'étais
pas grand et qui continue par :
J'avais des culottes en fromage blanc…
Là ce sont des petites bêtises d'enfant qui sont racontées,
farces et malices qui ne tirent pas à conséquence - glisser
sur les sabots, faire peur aux filles, galopiner en quelque sorte à
travers les rues du village. La fin de ce poème nous fait entendre
les mots, les cris pour appeler les animaux, de ôvo
! ôvo ! pour chèvres et veaux à
kery, tchia pour le cochon qui attend l'arrivée de sa
pitance, le groin dressé devant le bachat.
Nous sommes encore dans le pittoresque avec la
chanson du sifflet et la danse des
sabots. Le sifflet a été taillé par l'enfant
qui accompagnait son travail de la chanson appropriée, transmise
de génération en génération : Zabô,
zabô / Tchio de kanô / Si te vô pè zôbè
/ Foudrô te coupè le nè.
Pour Mes sabots, on appréciera
le rythme de la danse, rendu par les vers courts, aux sonorités
martelées, terminés par une unique rime en "o".
Tous ceux qui ont aimé danser la bourrée, en frappant du
talon, ressentiront, en lisant ce poème, la force de l'évocation.
N'oublions pas que dans ces soirs de fête, tout le monde était
mêlé. Les petits apprenaient en voyant faire les grands.
On pourrait encore rapprocher le poème intitulé : Le bo
/ Le bouc (p. 16) du monde de l'enfance car c'est un conte de "randonnée",
genre fort apprécié des enfants dont il développe
la mémoire : une histoire qui va du bouc au petit chevreau en passant
par la bique, puis qui reprend, du plus fort au plus faible, et finit
dans un grand concert de bêlements : Bioli…/ bioli…bioli…/
Et biale ïncore.
La vie de la campagne :
les animaux
Xavier Marcoux restitue dans ses poèmes l'atmosphère de
la vie quotidienne du village. On voit circuler et travailler bêtes
et gens, intimement liés pour le meilleur et pour le pire. Comment
s'étonner, dès lors, qu'il prête aux animaux des sentiments
humains ? Chaque animal a un nom - pas un numéro tatoué
dans l'oreille - et une personnalité.
Le cheval Bicho fut ainsi tout exprès
créé par le Bon Dieu pour être l'ami de l'homme et
de la femme. C'est le portrait, à la fois réaliste et légendaire,
d'un grand cheval, dur au travail, respecté de tous, à la
robe couleur café et aux sabots tou quatrou
bien forô, un bon cheval, doux et protecteur, au point
que l'homme et la femme - cela est dit - devant
cet ami / Se mettront à genoux. On n'est pas loin de
l'atmosphère de certains poèmes de Francis Jammes, comme
celui où il évoque Le p'tit cheval
dans le mauvais temps…, obstiné et courageux, dont
l'âme claire et naïve ira tout droit au paradis.
Lé donde (Les vaches dressées)
ne manquent pas de caractère, elles non plus. Les voici qui prennent
la parole, la Rouge et la Blanche,
comme dans un conte de Marcel Aymé. Elles travaillent comme des
bœufs, en couple inséparable, mais ne perdent pas une occasion
de rire et de papoter : Pô bioké
toté doué / nou bôyin de kô de koué !
Elles ne sont pas privées du plaisir d'être mères
et l'accouplement avec le taureau est raconté dans un style rabelaisien
fort joyeux que je laisse aux lecteurs le bonheur de découvrir.
Plus triste est Confesso d'ïn chin borgé
(La confession d'un chien berger). Le vieux chien, fameux berger, qui
jamais ne mordit l'une de ses brebis, raconte comment il a aimé
l'une d'elle, la Manchette, allant
jusqu'à boiter comme elle pour l'aider à marcher, la protégeant,
lui jappant son amour, inconsolable quand elle est vendue ; et par fidélité
à son souvenir, le voilà qui sera boiteux à jamais
! Trouvez donc une plus belle histoire d'amour au pays des hommes…
Le poète ne peut s'empêcher également de déplorer
le sort d'un jeune agneau que l'on a mis à mort et qui pleure sur
le plateau du boucher. Cette fois-ci, c'est le ton de la déploration.
Il n'avait pas fait plus de mal que l'agneau de La Fontaine et pourtant
la cause de sa mort, ce n'est pas un loup affamé mais la férocité
des hommes. Ce sujet n'est pas traité de façon mièvre
par Xavier Marcoux. Bien au contraire, c'est avec force qu'il s'élève
contre cette injustice, prenant la défense d'une faible créature
du Bon Dieu victime de la barbarie humaine. Points d'interrogation et
points d'exclamation témoignent de cette indignation.
Le poème, Une portée de cochons,
fait irrésistiblement penser à la fragilité des bébés
quittant le ventre douillet de leur mère pour affronter le dehors
: le froid, la recherche de la nourriture. Avant de naître ils jouent
à saute-mouton, à la course à l'âne, à
cache-cache, à la culbute ; ils chantent et dansent. Heureusement
après leur naissance, la mère nourricière est là
pour les aider. Cette histoire de bêtes est aussi une métaphore
de la vie des enfants insouciants et joyeux qui doivent un jour se lancer
dans la vie.
On lira encore avec intérêt le poème intitulé
Quoi, quoi ? qui présente de
nombreux cris d'animaux, de manière plutôt facétieuse.
La vie de la campagne : les travaux
et les jours
Dans les souvenirs de Xavier Marcoux on retrouve beaucoup d'évocations
sonores qui se rapportent aux diverses occupations des paysans, travail
quotidien comme la traite des vaches ou saisonnier comme le battage des
gerbes. Ces petites scènes deviennent très vivantes sous
la plume de notre poète.
Comme par hasard le mot "seaux" se dit
bru en patois, et le mot "bruit", c'est également
bru. Nous voici donc au pré, avec, dans l'oreille, ce son du jet
de lait bourru qui arrive dans le seau, bruit pointu, son métallique
au début (on n'a pas encore inventé le plastique), puis,
au fur et à mesure que le seau se remplit, le son est plus sourd,
le lait écume, et bientôt la surface du liquide se balance
au rythme de la bourrée des seaux. Il faut lire et relire ce poème,
plein de charme et de fantaisie. Jusqu'où iront ces seaux ? Ils
échappent à tout contrôle comme ceux de L'apprenti
sorcier de la légende. Notre poète s'amuse en écrivant
cette histoire dont la majorité des rimes sont en "u".
Plus sage et plus traditionnelle est la chanson du fléau. C'est
bien un chant qui accompagnait le travail de battage, éprouvant
pour les bras et les reins, pénible pour les yeux à cause
de la poussière. On entend : Pïn,
pan, pô, pïn, pan, pô. Pas besoin de traduire
! Chaque fin de strophe reprend ce refrain, chanté par toute la
collectivité. On voit les hommes, les femmes et toute la marmaille
est présente, lô mormayi.
Il y a même le tonton. C'est une activité vitale : ensuite,
il y aura le pain, ce régal, des taillons
de pain blanc, des taillons de gros
pain et cela mérite bien la peine des hommes.
Reste à présenter le sabotier de Chalmazel qui a l'amour
du métier et fait voler ses outils pour parer, creuser, racler
le bois et transformer, avec art, les bûches en sabots.
Le sentiment de la nature : un lyrisme
très personnel
Xavier Marcoux se révèle être, au fil de ses poèmes,
un amoureux de la nature, un homme sensible au lyrisme très personnel.
Commençons par Mon village. C'est
Nermond, le lieu de naissance. Dans ce texte, très bien composé,
le regard s'élève d'abord des bâtiments en pierres
aux arbres au-dessus, puis on découvre le plateau, et plus haut
encore, la forêt. Le regard s'abaisse ensuite vers les fleurs de
pissenlits qui émaillent le vert des prés. On devine la
volonté du poète de nous faire partager l'amour de son village
en nous guidant pour que nous en découvrions les beautés
les plus humbles. Il en connaît chaque détail : c'est "chez
lui".
Retenons encore l'hymne au printemps, thème éternel, mais
agréablement renouvelé ici. A côté de l'évocation
des oiseaux, des fleurs - violettes, pissenlits, pâquerettes - on
rencontre une verve plus campagnarde. La sève ne monte pas que
dans les plantes : elle inspire aussi les garçons, avec l'image
réaliste des "suçons" faits à leurs petites
amies ! Apprécions au passage le couplet qui ouvre et ferme le
poème :
L'orô ô bôdô lô
portô dô tin, Le vent a ouvert la porte du temps,
L'orô ô bôdô lô portô dô prîntin.
Le vent a ouvert la porte du printemps.
Mariage de papillons n'est qu'un prétexte
pour traiter du badinage amoureux. Deux fiancés se taquinent sur
le thème du "quand nous marions-nous".
L'amoureux répond, en se moquant, aux questions de la jeune fille,
qui ne manque pas d'en faire autant. Le tout sur un mode léger,
comme la danse de deux papillons qui se taquinent en volant de fleur en
fleur.
On trouve aussi bien l'éloge du vent : Il
court, court le vent / Comme un lièvre / Qu'un chien poursuit,
/ Plus vite encore au rythme rapide, comme essoufflé,
aux sonorités évocatrices des différents bruits produits
par le vent que la présentation de la fraise, modeste fraise des
bois difficile à trouver, mais si délicieuse et parfumée.
Encore très réussi, le poème qui peint la course
du Lignon. Les vers courts, haletants,
du début, sont comme la course d'un jeune enfant qui fait le fou,
avec la cadence de la danse. Une petite voix, peu d'eau, mais une grande
vitalité. A partir du pont, le ruisseau a plus d'ampleur : il porte
un nom et fait plus de bruit. Les vers s'allongent, mais c'est toujours
la fête car deux ruisseaux se sont rejoints :
Sôtin, sôtin, riyin, riyin, / Dansin,
dansin, chantin, chantin, /
Glou, glou, glou, / Ou'é nou, lu dou sïmplou.
Les choses se gâtent quand vient la maturité. La belle rivière
est polluée et sa destination finale (la
mer de Biribi ) fait plus penser à la prison qu'à
la liberté. Pauvre Lignon!
Le court poème Louis et Mélanie
nous fait vivre la vie simple d'un vieux couple tendrement uni. Tout est
dit en peu de mots : attentions réciproques qui signent le bonheur
(Pô te : mô Mélèni
! Pô te : mon Loui !)
Amandine et Sur
la route de Reculons sont comme des réminiscences d'anciennes
chansons françaises, adaptées aux lieux de l'enfance de
Xavier Marcoux.
Dans le premier texte, la belle Amandine se promène au long de
l'eau, et c'est le ruisseau de Grandris,
bien connu des habitants de Chalmazel. Mais la fin de l'histoire est heureuse
: la fille n'est ni séduite ni abandonnée, ce qui arrive
d'habitude dans ces anciennes chansons qui sont des mises en garde pour
les jeunes demoiselles.
Quant à la route de Reculons,
il s'y passe de curieuses choses : cette Madelon n'est pas bien farouche
et le conseil donné, c'est de ne pas passer sans la consoler !
Un poème très attachant nous fait rêver du ciel et
des constellations. Dans cette montagne, la nuit, le ciel est tout proche
et les figures qui sont dessinées ont toujours aiguisé l'imagination
des petits bergers : dans la petite musette du garçon sont enfermés
le petit chevreau tout en or et l'étoile qui dormait encore. Le
dimanche ils ont disparu, mais c'est au ciel qu'on peut les trouver désormais
:
Mê ou é veu ïn choroban Mais
j'ai vu un char à bancs
Djïn le sié, tchirô pô ïn boutchîn,
Dans le ciel, tiré par un chevreau,
E l'étialô dô borgé dourmé dedjîn.
L'étoile du berger dormait dedans.
Des histoires, encore des histoires…
Tous ceux qui l'ont rencontré savent que Xavier Marcoux aimait
raconter des histoires, des "histoires du temps passé",
selon les mots de Victor Hugo, mais aussi des "malices" qu'il
arrangeait à sa guise et de petits poèmes absurdes ou naïfs,
à la manière de poètes contemporains, comme Francis
Jammes, Jacques Prévert ou René de Obaldia.
Au compte des histoires transmises aux veillées, voici celle de
Pierre Paillat, qui devait beaucoup
amuser les auditeurs. L'homme est un avare qui trouve sur la route un
porte-monnaie gelé… Je vous laisse découvrir la suite
de l'aventure qui ne manque pas de piquant !
Le bouc de Bignado est un fameux reproducteur
et l'on se plaît à le vanter. Mais après la mort de
son maître, il est acheté par le maire, et le voilà
qui ne veut plus travailler. On s'amuse beaucoup à lire la fin
de l'histoire !
Une jeune chèvre est un conte
gaillard dans la tradition des fabliaux du Moyen Age. La conduite de cette
chèvre, facétieuse en diable, loin de scandaliser, devait
au contraire déchaîner les rires des paysans qui se trouvaient
ainsi vengés des juges, leurs ennemis de toujours.
D'autres poèmes sont de la même veine rabelaisienne : les
mots crus ne sont pas évités, au contraire. Ainsi dans
Le Jané lô Jèno
ou dans O lo borô.
Môrchan de poné est repris
et adapté d'une chanson ancienne. Ce marchand de paniers initie
la tante Dorothée à son métier ! Neuf mois après,
on voit le résultat… Tout le plaisir de ceux qui écoutent
est dans les sous-entendus et l'on finit par la chanson : cric, crac,
j'entends le bois qui craque / écoute, entends-tu le bois craquer
?
Le coq et le miroye (Le coq et le
milan) est une véritable fable digne de La Fontaine, par laquelle
nous apprenons pourquoi les milans, dit-on, mangent les poules et les
poussins.
Parfois l'on rencontre des textes proches de l'absurde, du "nonsense"
anglais. Détraqué, chamboulé
montre le monde à l'envers. On prend le plus grand plaisir à
renverser toutes les situations traditionnelles et l'on sent que l'énumération
loufoque pourrait durer encore plus longtemps, si le poète ne décidait
de conclure par un : Tô é dépotintô.
Dans La chèvre et le loup,
qui est en forme de chanson, on se croit dans l'univers de Desnos car
l'on rencontre trois limaçons qui s'en vont labourer, puis une
chèvre noire qui chante : alleluia, avant, la pauvre, de se laisser
manger par le loup.
Autres histoires sans queue ni tête dans Brayi
de coucu où la primevère en mal de confidence
raconte des choses extravagantes : qui peut croire, par exemple, qu'à
Saint-Didier, un blaireau chante des chansons alors qu'autour de lui dansent
des matous ? Cela ne fait rien, nous sommes dans la féerie du "Il
était une fois".
L'histoire intitulée : Pô d'émou
(Pas de jugeotte) est une leçon de sagesse populaire, racontée
sur un mode plaisant, léger. Un certain nombre de proverbes bien
connus y trouvent illustration. Un père donne des conseils à
son fils, plutôt irréfléchi, qui doit acquérir
un meilleur jugement, apprendre à économiser, freiner ses
désirs, calculer pour avoir un bon avenir… Bref, on est en
plein conflit de générations.
Plaisant également le petit poème des "douleurs",
qui met en scène plusieurs personnages souffrant de ces fameuses
douleurs. On entend les plaintes de la Pélagie et du Guste de Traveloux,
reprises par l'âne qui brait à belle voix ! Des douleurs,
il y en a pour tous, mais elles n'ont jamais fait mourir personne, elles
alimentent surtout les conversations.
Beaucoup de poèmes traitent donc de sujets plutôt amusants.
On fait passer bien des idées grâce au ton comique, sans
la pesanteur de la leçon de morale. Cependant Xavier Marcoux est
parfois plus grave sans devenir pour autant ennuyeux.
Un homme qui se retourne sur son passé
Malgré des apparences légères, Le
tin ko fôro (Le temps qu'il fera), montre une certaine
nostalgie du temps qui passe. Sous les petites histoires amusantes qui
illustrent chaque jour de la semaine, on voit en fait passer les saisons
de l'année et même les saisons de la vie. C'est court, la
vie !
Mais où sont les neiges d'antan…,
semble dire le poète dans le texte : Intô
lé donc ? (Où est-il donc ?). Oui, où
sont-ils donc tous ces personnages des histoires entendues aux veillées
? Perdus, bien perdus dans la nuit noire du temps écoulé
et l'on ne perçoit plus que le intô lé, intô
lé donc, que reprend tristement l'écho.
Même inspiration pour Viôle (Sentier)
où l'on constate qu'il n'y a plus de sentier à travers les
prés. Maintenant les bêtes sont gardées par des rangs
de fil de fer barbelé. Plus de sentier, plus de berger, plus de
garçon pour conter fleurette… Dans ce court texte, ce sont
les mots plu et yô
mè (y a seulement) qui résonnent sinistrement
tout au long des vers.
Xavier Marcoux évoque encore en patois des moments heureux d'amitié
partagée autour d'un bon repas rustique et cela donne : Sopô
de chaô, où l'on retrouve plusieurs figures du
groupe "Patois vivant" : Et glou, glou,
glou / Pour la soupe de choux.
Il essaie surtout de sauvegarder ce qui est le plus important, à
ses yeux, la saveur de la langue, et même sa verdeur, comme dans
le poème intitulé : Jinto lingo
où des expressions très imagées disent
une certaine sagesse paysanne. Et Notrô
lingô est un véritable hymne au patois forézien,
la vraie langue, qui dit plus que des mots, qui dit les habitudes, les
coutumes et donne son sens à la vie. Les deux dernières
strophes de ce poème ont de vrais accents de ferveur :
Notre langue / C'est un trésor / Elle
a cent mille étés et dure encore. / Notre langue gardons-la
donc / Et à nos enfants donnons-la donc. On sent qu'il
veut se convaincre lui-même. Il conclut ainsi, et, curieusement,
en français seulement :
Nous sommes bilingues / Restons bilingues : Notre langue est un trésor
/ Gardons notre trésor.
Qu'en est-il de cette exhortation, de cette bouteille jetée à
la mer en 1977 par un amoureux du patois ? Je ne saurais conclure là-dessus.
Les patoisants seront mieux à même de le faire, eux qui font
le succès des veillées de Patois vivant, ce qui est déjà
une réponse. Mais on peut dire que les textes de Xavier Marcoux
sont ceux d'un véritable poète, sensible et inspiré,
qui varie les tons et les rythmes, et qui nous laisse ce témoignage
irremplaçable sur le monde de son enfance et de sa jeunesse. Le
Père Gardette souhaitait l'émergence d'une poésie
forézienne. Celle de Xavier Marcoux répond à son
vœu.
un
cahier de 60 pages, (21 X 29,7)
disponible au
Centre Social de Montbrison
13 place Pasteur,
42600 Montbrison
tél. 04 77 96 09 43
mèl
centresocial.montbrison@laposte.net
site
perso.wanadoo.fr/centresocial-montbrison